À l’occasion de la sortie de leur livre L'Habiter, un impensé de la politique de la ville (éditions de l'aube) nous avons souhaité rencontrer Barbara Allen et Michel Bonetti, chercheurs consultants au Sens Urbain après avoir été directeurs de recherche du Laboratoire de Sociologie Urbaine Générative au CSTB.
Les quatre chapitres de ce livre décortiquent trente années de politique de la ville et détaillent une analyse atypique des facteurs d’échec et de réussite de cet investissement national en faveur des quartiers défavorisés. Les auteurs ont choisi, comme le préconisait en 2013 la cours des comptes dans son rapport intitulé « La Politique de la Ville une décennie de réformes », de réconcilier les volets urbain et social. Ils définissent la notion d’habiter comme une rencontre : celle de l’habitant avec son cadre de vie. Il en découle une analyse fine des modes d’habiter, basée sur le rapport de l’individu à son habitat et permettant une lecture précise des dysfonctionnements locaux. Le rapport qu'entretiennent les ménages à leur logement et à leur quartier est croisé avec leurs projets et leurs parcours résidentiels, afin de décrire un large panel de situations habitantes.
Barbara Allen et Michel Bonetti le rappellent : on a trop longtemps sous-estimé les capacités de l’habitat à constituer un levier d’intégration sociale. Des mécanismes complexes sont mis en lumières dans la construction du rapport à l'habitat : le rapport aux autres, voisins, résidents du quartier, ou de la ville, mais aussi le rapport du quartier à son environnement proche et lointain. Aménités, déplacements, existence d’un ailleurs désirable, capacités à se projeter dans un nouvel habitat, tous ces facteurs participent à l’appropriation et à l’acceptation -ou non- de son cadre de vie, et ont des répercussions directes sur l’investissement de la population dans les structures sociales locales et le soin accordé aux espaces publics et collectifs.
Ce que les auteurs nous enseignent, c’est que les pratiques et les représentations liées à un quartier ne sont jamais le fruit du hasard et se construisent sur des aspects bien réels dont les acteurs publics ou para-publics peuvent avoir la maîtrise. Nous les avons rencontrés en janvier dernier, dans un café du 9e arrondissement pour en savoir plus sur leur démarche et leur travail.
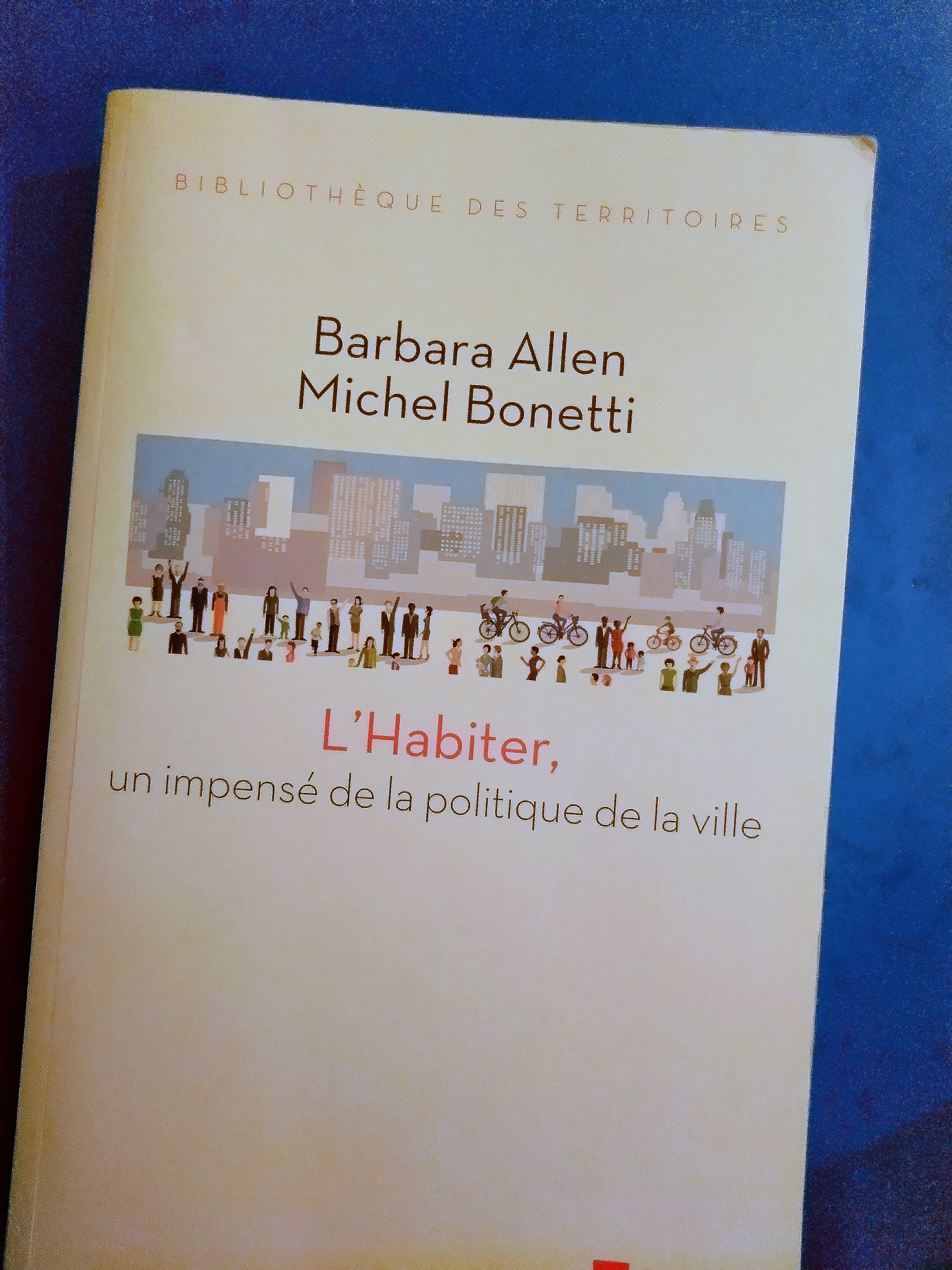
Entretien
C’est à partir de nombreux travaux menés autour de l’habitat et du logement (habitat individuel dense, habitat tzigane...) que les deux chercheurs ont commencé à nourrir le sujet de l’habiter dans les grands ensembles et à s'intéresser plus particulièrement à la notion d’intimité. Ils affirment que les grands ensembles ne sont pas seulement issus de contraintes techniques et économiques mais également - et surtout - de choix politiques. Un parti-pris revendiqué, en rupture avec les discours courants sur le sujet, et qui donne une coloration particulière aux thèses soutenues dans leur ouvrage.
Sur-Mesure : Quels constats portés sur la politique de la ville ont motivé votre recherche ?
À vrai dire, ça ne s’est pas complètement passé dans ce sens : nous avons travaillé pour la Caisse des Dépôts et Consignations qui avait mis en place un vaste programme d'évaluation dynamique dans le cadre de la Politique de la Ville. Un outil d’aide à la conduite du changement, pour informer les acteurs et leur permettre d’ajuster les actions qu’ils conduisaient. Nous avons également montré qu'il fallait faire évoluer les organisations, ce qui constitue un autre grand impensé de la Politique de la Ville. Dans ce cadre, nous avons mené un travail avec de nombreuses structures et particulièrement les bailleurs sociaux. Ces derniers avaient organisé une décentralisation de leur gestion de proximité (en 1990) à une échelle très fine. Cela posait la question des effets sociaux, mais aussi de ce qu’on entend par « effets sociaux » : c’est par là que tout a commencé.
Dès le début, Michel était convaincu que si les organisations ne bougeaient pas, tout cela ne servait à rien. Rétrospectivement (et c’est une des erreurs que nous avons commises) nous sommes partis des bailleurs car, à l’époque, ce sont eux et non les villes qui assuraient la gestion urbaine de proximité. Nous avions le sentiment que dans tous les projets qui étaient conduits dans les quartiers, on ne se préoccupait pas du fait que ce sont avant tout des lieux d’habitat pour des milliers de personnes. Ils étaient appréhendés comme des lieux de concentration de certaines populations et de difficultés. On a ignoré cette opportunité : il y avait dans ces quartiers des enjeux pour les habitants, liés au fait que l’habitat constitue un levier pour améliorer les situations individuelles et collectives.
Dans nos enquêtes, de nombreux quartiers avaient les mêmes indicateurs socio-économiques, et pourtant, les dynamiques à l’œuvre étaient radicalement différentes.
En travaillant dans ces quartiers, nous avons constaté que les diagnostics étaient trop pauvres et se restreignaient aux indicateurs établis par la Politique de la Ville, qui malheureusement, ne disent pas grand chose des pratiques habitantes. Dans nos enquêtes, de nombreux quartiers avaient les mêmes indicateurs socio-économiques, et pourtant, les dynamiques à l’œuvre étaient radicalement différentes. Pourquoi ? C’est cette question que nous avons tenté d’appréhender, afin de proposer des démarches permettant de créer des conditions d’évolution pérennes dans les quartiers prioritaires.
Les objectifs génériques de ces programmes comme « la cohésion sociale », ne sont jamais spécifiés, reformulés, adaptés aux contextes locaux. Ils ont permis d'atténuer les difficultés, sans pour autant permettre aux quartiers de sortir du dispositif. Le saucissonnage statistique de la population des quartiers ne permet pas de percevoir qu'il s'agit avant tout de personnes, c’est pourquoi nous insistons beaucoup dans le livre sur l'enjeu des identités sociales. Comme les gens sont pauvres, ils sont réduits à cette catégorie, alors que dès les années 80 des chercheurs insistaient sur un aspect fondamental, à savoir la diversité des identités sociales. Par ailleurs, pour les gens de l’extérieur, ces personnes sont assimilées au lieu où elles vivent.
Sur-Mesure : Vous réconciliez les dimensions urbaine et sociale, notamment à travers cette définition : le mode d’habiter, c’est la rencontre entre une personne et son habitat. Comment avez-vous construit cette corrélation ?
La notion de mode d’habiter et celle de situation habitante, qui désigne la dynamique collective d'un quartier, nous sont apparues tout de suite, dès les premières enquêtes. Nous avons identifié des profils, des classes, qui comportaient toute une série de représentations, de caractéristiques, des points communs forts qui les différencient des autres. La notion de type de « mode d’habiter » est venue au cours des enquêtes, nous avons constaté que les classes se construisaient toujours autour des mêmes variables, même s’il existe des variations selon les types.
La question de la clarification des relations entre l’urbain et le social nous est venue très récemment. En effet, on a vu émerger toute cette critique portée par le milieu de la recherche affirmant que la rénovation urbaine a certes amélioré le cadre de vie des habitants, mais qu'elle n'a absolument pas modifié leurs conditions de vie. François Lamy, lorsqu'il était Ministre délégué chargé de la Ville, avait notamment déclaré qu’avec les Conseils Citoyens, « on allait désormais s’occuper de l’humain ». Comment peut-on dire une chose pareille ? Être intervenu sur l’espace, sur le cadre bâti, l’organisation, les aménagements, ça n’est pas de l’humain ? On a opposé trop longtemps cadre de vie et conditions de vie, on s’est concentré sur la qualité médiocre du bâti et sur la concentration de pauvreté, sans se demander comment on pouvait faire des grands ensembles des lieux plus agréables, des espaces collectifs de meilleure qualité.
La question de la cohabitation est là depuis le début de la politique de la ville sans jamais avoir été réellement traitée, au delà des notions de seuil et du « pourcentage de telle ou telle catégorie d'habitants ». On a posé la vie sociale comme un objet à côté du reste, alors qu’elle se construit partout. Tous les lieux médiatisent cette vie sociale : à partir de là, le rapport entre l’organisation de l’espace et la manière dont les institution prennent en compte la qualité des lieux est fondamental pour assurer la cohabitation entre les ménages ayant des cultures et des modes de vie différents. Pourtant, on a laissé ces quartiers se dégrader d’une manière hallucinante. La vraie question est : qu’est-ce qui a permis aux gens de tenir dans cet état de délabrement général ?
Habiter dans un immeuble sympa, un quartier agréable… ou vivre dans un immeuble insalubre, dans un quartier insécurisé : en termes de conditions de vie, ce n’est pas tout à fait la même chose !
L’organisation des professionnels et des institutions sur cette question est intéressante : vous trouvez d’un côté les urbanistes et de l’autre les acteurs sociaux. Ces derniers ont un discours connu sur la rénovation urbaine « elle améliore le cadre de vie, le décors, mais elle ne touche pas aux conditions de vie ». Comme si l’espace urbain ne faisait pas partie des conditions de vie. Habiter dans un immeuble sympa, un quartier agréable … ou vivre dans un immeuble insalubre, dans un quartier insécurisé : en termes de conditions de vie, ce n’est pas tout à fait la même chose ! Le problème est que ces mêmes acteurs, lorsqu’ils parlent de social, ne parlent pas des relations sociales que les gens entretiennent, mais de la fréquentation des équipements et du dynamisme associatif. Parallèlement, personne ne travaille sur l'amélioration de la cohabitation.
Reconnaître l’importance de l’habitat dans le vie des personnes, est une approche qui permet de réunifier la personne. Des gens vivent dans ce cadre, cherchent à y élever leurs enfants, à avoir des projets. Le fait d'entrer par la question de l’habitat fait tomber naturellement l'opposition urbain/social. Ce qui ne veut pas dire par ailleurs que l'amélioration de l'habitat résoud tous les problèmes : il y a des enjeux spécifiques, tels que l'éducation et l'emploi, qui doivent faire l’objet de politiques à part entière. Parler d’habiter, c’est parler de la relation d’une personne à son territoire. Dans les interventions, et de manière opérationnelle, celà nécessite de concevoir des projets globaux et non plus un collage de projets thématiques (commerce, éducation, cadre de vie...).
La politique de la ville a souffert de trop nombreux problèmes de méthode. Des choix politique douteux, des projets légués dans leur intégralités à des « urbanistes stars », alors qu’ils auraient mérité la mobilisation d'équipes pluridisciplinaires. Les territoires ont été saucissonnés et ils ont fait l'objet de découpages en secteurs prioritaires, dont la pertinence reste à justifier, des projets urbains ont été conçus sans jamais concevoir de véritables projets de développement....
Sur-Mesure : Vous décrivez dans le livre des méthodes ou des outils de diagnostic qui semblent assez inédits : les porteurs de projet ont-ils aujourd'hui les moyens de mener des diagnostics aussi précis ?
Les enquêtes que l’on a faites sont des dispositifs relativement lourds. Nous sommes intervenus là où les acteurs rencontraient une situation d’impuissance face aux dysfonctionnements, où se posaient des questions stratégiques de fond. Il n’y a évidemment pas d’injonction à déployer ce genre de méthode pour être en capacité de penser ou d’agir. Il faut très simplement se poser des questions : quels sont les lieux que les habitants du quartier pratiquent ? Ceux qu’ils ne pratiquent pas ? Y a-t-il vraiment des polarités urbaines et si oui sont-elles investies par les habitants ? Distingue-t-on des zones différentes dans les quartiers, des lieux d’attraction et des lieux de rejet ? Pourquoi ?
Il faut se demander comment les gens vivent là, tout simplement. Un bon travail d’observation, couplé à des outils d'enquête aisément accessibles peuvent suffire. L’agglomération de Nantes par exemple, a mis en place un baromètre de la qualité de vie dans les quartiers prioritaires. Tous les deux ans, l’enquête téléphonique est renouvelée auprès de 150 personnes par quartier. C’est un dispositif plutôt léger qui permet néanmoins d'avoir une perception de l’évolution de chaque quartier et une comparaison entre les quartiers. La mobilisation des acteurs professionnels est une autre ressource : quels éléments de diagnostic peuvent-ils apporter en fonction des publics qu’ils côtoient, des sujets qu’ils maîtrisent ?
Un projet d’accession qui échoue, un déménagement consécutif au chômage ou à une séparation engendrent des situations de fragilité, dont il faut avoir conscience.
Au-delà de l’observation fine et de l’attention aux modes d’habiter, il y un troisième point fondamental à prendre en compte dans la conception des projets : l’analyse des trajectoires résidentielles. Il faut avoir une idée de la structure et des durées d’installation et se donner les moyens d’en comprendre le sens. Avoir une grande proportion de personnes présentes depuis longtemps peut autant signifier que les gens se sentent bien ou qu’ils sont captifs et ne savent pas où aller. Ensuite, le « d’où je viens » va engendrer des postures habitantes différentes. Un projet d’accession qui échoue, un déménagement consécutif au chômage ou à une séparation engendrent des situations de fragilité, dont il faut avoir conscience. Au contraire, des personnes qui arrivent de foyers, ou d’hôtels sociaux et qui soudain accèdent à un logement sont dans des situations d’amélioration de leurs conditions de vie, pour elles c’est une opportunité.
Enfin, il y a la question du sens de l’installation primaire et secondaire. L’installation primaire correspond à la perception du lieu de vie au moment précis de l’emménagement. L’installation secondaire concerne les qualités ou les problèmes d’un lieu qui sont découvertes progressivement. Ces notions permettent de définir le sens que l’on donne à son installation. Aux Tarterets, par exemple, personne ne voulait aller dans ce quartier. Or, quand les gens se sont installés, ils ont découvert des qualités du quartier qu’ils n'imaginaient pas et ils ont pu négocier le sens contraint de leur installation et ont évolué vers un véritable attachement à ce lieu. A l’inverse, dans le cadre d'un projet de rénovation à Saint Nazaire, les ménages avaient choisi le quartier dans lequel ils souhaitaient être relogés, sans avoir tous les éléments pour étayer leur choix. Finalement, il ne s’y trouvaient pas toujours aussi bien qu'ils l'avaient espéré et la question du choix s'est révélée compliquée à gérer.
Sur-Mesure : Quels sont les objectifs en termes de projet de société que vous projetez dans les quartiers en renouvellement urbain (mixité, trajectoires résidentiels) ? Est-ce que vous ne déplacez pas le curseur sur le “bien habiter”, l’intégration ?
Pas vraiment, la question fondamentale est l’enjeu du sens de l’habitat, de donner la possibilité aux habitants de trouver dans leur habitat des qualités de protection, d’intimité, de confiance1. Ces qualités vont permettre aux personnes de développer la relation la plus favorable possible à leur habitat. Bien sûr, certaines personnes sont tellement en difficulté qu'elles ont perdu tout espoir, voire la capacité d'espérer et il faudra alors des processus spécifiques pour leur permettre de se retrouver. Il faut avancer en se demandant comment les habitants peuvent trouver dans leur habitat - au sens large - les ressources pour négocier le présent et élaborer un futur possible. Certains habitants n’ont malheureusement plus accès à ce processus : ils ne parviendront pas à investir le futur, car ils n'ont plus de capacité de projection qui pourrait donner du sens au présent.
C'est pour cela qu'il faut également ouvrir la réflexion au-delà des quartiers, alors que la Politique de la Ville a essentiellement resserré la focale sur eux. Il faut envisager la manière dont les habitants peuvent accéder aux aménités urbaines et être vraiment des habitants de la ville, et donc des citoyens. Car leur vie ne se réduit pas au quartier dans lequel ils vivent. Il faut ouvrir des échelles bien plus vastes que celle du quartier, et permettre aux habitants d'y accéder. Cette ouverture permet d'offrirdes nouvelles pratiques relationnelles et des ressources identitaires nécessaires pour pouvoir se projeter dans un après.
Si un certain nombre d’habitants est de plus en plus fragilisé sur le plan économique, l'amélioration de l’habitabilité au sens large doit permettre de soutenir ces personnes.
Finalement, il faut travailler au cas par cas et réfléchir au « devenir possible » de chaque quartier et de ses habitants. Nous devons arrêter de vouloir plaquer la même chose partout, nous savons maintenant que ce n’est pas une politique publique efficace.
Note de la rédaction
-
En référence aux quatres composantes de l’habiter, détaillés dans le livre : la protection - l’abri / le ressourcement - l’intimité / la relation avec d’autres et aux autres / confiance et inscription dans une temporalité) ↩
